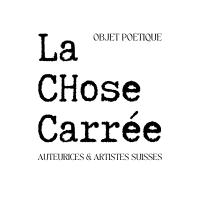Fabuler, librement, au sommet d’un pavé mal fixé, pointant hors du sol. Je veux crier, mais je chante et je compose, c’est plus poétique. Je marmonne souvent, recroquevillé vers l’intérieur. Mes murmures n’atteignent jamais les oreilles des passantes de la place.
Au pied de la statue, je suis chevalier habsbourgeois, compagnon d’armes. Je suis ménestrel, à la cour du roi, jouant les mélodies des autres. La figure de marbre de Satzlbourg est un prince, abîmé par le temps, ayant perdu de sa superbe, qui surplombe le croisement. Ses joues sont noires d’usure. Je fais encore davantage pâle figure. J’essaie pourtant les notes les plus osées, les interprétations les plus recherchées. C’est une place centrale, au cœur de la cité. Je suis son seul spectacle authentique.
Le moteur d’une voiture de sport, hors de prix, ronronne entre les arcades de la vieille ville. Personne ne me regarde. Je veux juste qu’on m’entende. “Pourquoi ai-je tant de rage que la foudre?”, murmuré-je entre les lèvres. Une jeune femme tend l’oreille, se retourne, me regarde et secoue la tête. Elle entre dans un magasin d’habits de luxe. J’ai perdu mon dernier carton, cette nuit, durant la tempête de neige.
“Bande de connards, autant que vous êtes!” Je ne contrôle plus rien, trop de fatigue ou peut-être d’inattention. Je reprends mon violon, vascille sur mon caillou, à deux pas de la fontaine, sous l’œil princier d’un reste d’histoire. J’oscille entre colère et tristesse. Pris d’un tremblement fulgurant, mon instrument tombe au sol, je m’assieds en tailleur à ses côtés. La pointe du pavé s’enfonce dans ma fesse droite tandis que je réchauffe mes mains douloureuses tant bien que mal.
Voilà bientôt cinq ans que je vis dans le quartier, à l’abri d’une arcade, devant la pharmacie dont le propriétaire me laisse un espace où déposer mon sac de couchage et mes loques d’habits durant la nuit. Il y a six ans, je jouais encore dans l’orchestre de l’opéra non loin d’ici, avant mon arthrose avancée fulgurante. Et pourtant, personne ne me connaît. Je suis une statue, non de marbre, mais de chair, d’âme et d’os. Les regards de serpents des passantes me pétrifient, tous les jours, comme les gorgones. Or, j’ai l’art à mes côtés.
Un autre murmure m’échappe, en me frottant les bras pour les réchauffer: “Je suis d’ici autant que vous!” Le vent redouble, les flocons redoublent. “Je suis d’ici autant que vous!”, crié-je. Je reprends un instant mon violon troué, mais l’archet tombe immédiatement au sol. Mes doigts sont encore trop froids, trop souffrants.
Peu de gens jettent une pièce dans la coque de l’instrument. Je chante, assis, renforçant ma voix avec les deux mains. Deux à trois euros seulement, aujourd’hui, alors qu’il est déjà midi et que les passantes s’agglutinent dans les restaurants de la place. Quelqu’un m’a offert un croissant en me souhaitant une bonne journée et de joyeuses fêtes, à l’aube. Je sors les trois derniers journaux de mon sac ravagé par le bitume, je les pose sur les pavés et me couche dessus. A peine je m’y installe qu’ils sont déjà mouillés. Peu importe, je ne sens plus mon dos depuis bien longtemps.
L’épée tendue du chevalier de marbre coupe un nuage, la cicatrice bleue perce une lueur dans la grisaille. “Qu’est-ce que tu fous?”, me lance un vieil homme en me passant par-dessus la tête. Je serre le violon contre mon corps comme la peluche d’enfance que je garde encore dans mon sac, seule compagne pour la nuit. J’aime fixer le ciel, au milieu du jour. Cela me calme, même s’il s’agit d’une simple éclaircie et aucunement de l’annonce d’un jour meilleur.
Un cycliste m’écrase les jambes. De la petsch gicle à son passage, jusqu’à mon visage. “Dégage de la route!” m’harrangue-t-il en filant à toute allure sur la voie cycliste. Je trémousse, rigole, de plus en plus fort. “Tous des merdeux autant que vous êtes!” De l’autre côté de la place, un couple se retourne. Elle hoche les épaules. Il fait une grimace.
Les flocons s’épaississent à vue d’œil, comme chez moi, au début de l’hiver, à Kherson. Les klaxons se multiplient. Le camion poubelle vibre sur le bitume. Ses roues effleurent mes pieds. Son odeur pestilentielle laisse derrière lui un souffle chaleureux, enfin un peu de réconfort.
“Arrêtez!” En sortant de l’horloger, deux touristes me filment et éclatent de rire. Je souris, désespérée, pinçant l’une ou l’autre note sur les cordes de mon instrument. Un père Noël titube sur le trottoir. “Bouge ton cul!”, me crie un adolescent.
Des tableaux prennent forme dans le ciel. Je contemple la mer de nuages, je voyage. L’isolement romantique de Caspard David Friedrich se mêle aux corps torturés d’Egon Schiele dans une symphonie de lumières. C’est un peu ma nouvelle maison.
“Tout va bien?” s’inquiète un passant et sa compagne en m’aidant à me relever. “Oui, oui, je peins le ciel pour le rendre plus vivant, plus fantastique, plus merveilleux”. Elle sort un bout de pain de son sac, me le tend. Il enlève mes journaux du sol. Je manque de glisser sur le pavé mal taillé. L’homme me retient. La femme range mon violon, son compagnon me pose sa veste sur les épaules et nous entrons dans leur appartement de la place.
Depuis leur salon, avec une verveine, le vert veiné jaune du visage princier est plus proche, reflète les rayons transperçant les cristaux de neige. Il paraît moins hautain, mais toujours aussi érodé pourtant.