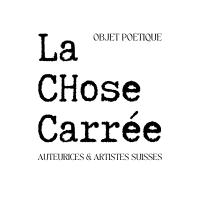L’inconfort est l’unique confort. Il est la seule douleur qui conforte la vie. La seule couleur que comporte la vie.
Il est cette voie à l’arrivée indéfinie. Cette voix qui, en nous, repousse incessamment le chemin incommensurable. Ce chant profond qui murmure en criant, « N’essaie pas. Ne change pas. Ici, tout est bien ». Il ment le confort, l’inconfort ; il tend le piège, nous emprisonne dans un univers prévisible, dans un cosmos devenu cercle fermé ou simple rue quotidienne d’un chemin prévu.
Je marchais. Je marchais quand soudain je rencontrai des escaliers comme de fer forgé ; un sol qui paraissait perforé, des marches couleur abîme. Il me fallait avancer, ou alors retourner dans un labyrinthe de terre insondable assidûment parcouru et pourtant jamais déchiffré, toujours déchirant. Je m’élançai. Je mis un pied sur l’abîme dessiné et décidé par l’humain, et je tombais. Je sentais l’air rapide —ses caresses frappantes—, je sentais l’attraction d’une terre éloignée mais mon corps, lui, faisait mouvement inverse.
Je levai les yeux comme pour ne plus sentir que l’abîme ; pour ne plus le voir et seulement le percevoir. Je levais les yeux en me forçant et je respirais lentement —j’essayais—, je sentais mon cœur battre toujours plus rapidement, plus fort, plus saccadé, plus apeuré ou excité lorsque, soudain, je remarquai le ciel : tombant, il se faisait plus proche et, finalement, je touchais terre.
C’était l’ultime marche d’une voie inexplorée, l’ultime pas menant à un nouveau chemin, infini. L’abîme, le vide, la chute, la perte, l’incompréhension, l’ascension, le ciel, le soleil, la terre ; c’était la conscience d’un univers ouvert.
Le sentiment d’inconfort n’est pas ennemi par essence, mais le confort est bien souvent la création d’un système, d’une artificialité, d’un chemin de perte, de non-être ; l’étouffement de notre quintessence.C’est en habitant ce sentiment qui nous retient et nous restreint, en l’écoutant et en l’apprivoisant pour qu’il nous accompagne, que nous marchons vers notre véritable secours ; le retour à notre essence, la découverte de notre flux changeant, l’acceptation d’un centre en constante recherche de sens ; la richesse de notre infini indéfini.
Mis pies tocaban el penúltimo tramo de la escalera cuando sentí que algo ascendía por la rampa, opresivo y lento y plural. La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos.
Mes pieds touchaient l’avant-dernier barreau de l’échelle quand je sentis que quelque chose progressait sur la rampe, oppressif et long et pluriel. La curiosité l’emporta sur la peur et je ne fermai pas les yeux.
Jorge Luis Borges, «There Are more Things», Le livre de sable, 1975