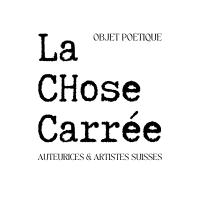Cet été, il a fait chaud, très chaud,
Chaud à en faire suer les murs et pleurer les jours d’hiver.
On aurait dit une fièvre. Bouillonnante aux tempes, corrosive. Qui s’installe jusque dans les couloirs brûlants des appartements vieux d’un temps où le dérèglement climatique n’était pas si préoccupant…
Elle s’est accrochée partout cette fièvre. J’avais même l’impression de la voir dans les regards qui se posaient sur moi dans la rue.
Une méchante impression que le feu consumait les âmes et envoyait des jetées de lave par les yeux, qui formaient des plaies cendrées, de plus en plus profondes, sur la fleur de ma peau.
C’était donc ça, oui, une fièvre – celle qui fait délirer.
Celle qui m’a transportée dans une course folle.
J’ai voulu tout vivre, vite – à en faire suer mes aisselles et pleuvoir mes yeux.
Surmonter les chocs thermiques entre mon bureau givré et mes pauses caniculaires.
Remplir ces dernières d’aventures, de peau brûlée, de danses vertigineuses, de concerts assourdissants, de trains qui me donnent la nausée, de lectures qui forcent l’introspection, de glaçons en terrasses qui fondent trop vite, de sable piquant et de forêts de pins odorantes et collantes.
Enchaîner, enchaîner, enchaîner et toujours cette sensation d’être dépassée, de ne pas faire assez.
J’en suis même arrivée à détester mon corps d’être si faible, si lâche, face à toutes mes ambitions estivales.
Caroline Bachmann a dit :
“Notre corps a un potentiel de savoirs à côté duquel on passe, si on l’oublie”
Au début de l’été, j’ai choisi l’amnésie.
Pourtant, je sais que ni mon corps, ni mon esprit, et encore moins mes émotions, n’ont le cardio pour mélanger toutes ces choses, les vivre pleinement et les accumuler sans reprendre mon souffle. Il y a déjà tellement d’informations dans le monde, dans une rue, dans une pensée ou dans une larme.
Une tempête émotionnelle qui me guette à chaque instant.
Là, quand je repense à tout ça, je me vois comme une plante terriblement mal traitée – inondée par des larmes trop salées qui font pourrir mes racines et brûlée par ma soif de soleil, laissant des stigmates à la surface de mes feuilles.
Et comme toute plante qui a traversé d’intenses variations, à un moment donné, je croule sous mon propre poids et m’affaisse – lourdement.
Autrement dit, mon corps, ce corps que je trouvais lâche, me prouve raison et me lâche pour de bon.
Alors, d’un coup, mes membres sont lourds, ankylosés.
Mon crâne, paralysé par une maladie salvatrice,
M’oblige à ralentir d’un coup sec,
À incarner la langueur délicieuse d’été et enfin, me reposer…
Dehors, le soleil brille, je crois.
Les gens jouissent des beaux jours, j’espère.
Moi je m’enfonce dans un lit chamallow
Je somnole, j’écoute, je sens
les légères ondulations d’un rideau fin
les murmures lointains des passant-es qui se rendent à la baignade
le grésillement de la musique qui est jouée dans la cuisine
les petits pas des petits chats sur le parquet
l’eau qui coule du robinet sans savoir à quoi elle sert à cet instant
l’odeur des plats préparés par mon amoureux/jardinier/guérisseur aux petits oignons
l’arbre aux mille oiseaux à côté du balcon qui vibre de toutes les âmes qui l’habitent
Ma tête est lourde de maladie et si légère en même temps.
Les petites choses deviennent immenses. Et belles, si belles.
Et enfin, vient le temps où l’amour est le seul remous qui fait sauter mon cœur,
un jacuzzi de désir et de tendresse
Le temps long, étiré, indifférent à la frénésie estivale
Où les instants se ressemblent et resplendissent toujours plus la fois d’après
Le temps où on respire avec le ventre et où on laisse les pensées divaguer
Le temps doux de l’été
L’ennui couleur miel des dimanches éternels